Publications 2025
 Les conflits de compétences juridictionnelles au regard des droits individuels
Les conflits de compétences juridictionnelles au regard des droits individuels
Auteur : Audrey-Pierre So’o
Editeur : LGDJ
Collection : Thèses
Sous-collection : Bibliothèque de droit public
Numéro du volume : 344
1re édition
Parution : 10/06/2025
EAN : 9782275161310
720 pages
Les notions d’âge d’or et de décadence ne cessent de hanter l’âme des peuples. Ceux-ci – persuadés que leur temps présent est placé sous le sceau d’une insupportable régression – vantent naïvement les mérites d’un passé glorifié. Aussi le BAV (Bulletin annuel de Villetaneuse) ne pouvait-il faire moins que de se pencher, de manière pluridisciplinaire, sur le couple « âge d’or/décadence ». Droit, histoire, histoire des idées politiques, sociologie, science politique et économie sont conviés pour comprendre comment nos sociétés se nourrissent de cette éternelle dualité : l’esprit de décadence accouplé à la nostalgie héroïque de ce qui est réputé avoir été. Les thématiques abordées – l’anarchisme, la Révolution française, la Ve République, l’Europe, les États-Unis, la marchandisation accrue de notre environnement social, le rôle du juge, la Ville de Paris – s’avèrent aussi riches que variées. Elles permettent de comprendre qu’une société a besoin de mythes, de se penser et de se forger au regard d’un héritage idéalisé. Si la réflexion centrée autour des notions d’âge d’or et de décadence possède une vertu, c’est celle de rappeler que le vouloir-vivre ensemble n’est pas (seulement) le fruit d’un positivisme normatif étriqué et réducteur. Les idées portent le monde ; la mission des sciences sociales est précisément de se faire le héraut d’un tel principe. En soulignant peut-être que magnifier par trop le passé fait injure à un présent qu’il nous appartient de construire, sans nous lamenter plus que de raison…
 Âge d’or et décadence
Âge d’or et décadence
Parution : 3 avr. 2025
ISBN : 978-2-38600-126-0
Éditeur : mare et martin
Sous la direction de : Franck Laffaille
Les notions d’âge d’or et de décadence ne cessent de hanter l’âme des peuples. Ceux-ci – persuadés que leur temps présent est placé sous le sceau d’une insupportable régression – vantent naïvement les mérites d’un passé glorifié. Aussi le BAV (Bulletin annuel de Villetaneuse) ne pouvait-il faire moins que de se pencher, de manière pluridisciplinaire, sur le couple « âge d’or/décadence ». Droit, histoire, histoire des idées politiques, sociologie, science politique et économie sont conviés pour comprendre comment nos sociétés se nourrissent de cette éternelle dualité : l’esprit de décadence accouplé à la nostalgie héroïque de ce qui est réputé avoir été. Les thématiques abordées – l’anarchisme, la Révolution française, la Ve République, l’Europe, les États-Unis, la marchandisation accrue de notre environnement social, le rôle du juge, la Ville de Paris – s’avèrent aussi riches que variées. Elles permettent de comprendre qu’une société a besoin de mythes, de se penser et de se forger au regard d’un héritage idéalisé. Si la réflexion centrée autour des notions d’âge d’or et de décadence possède une vertu, c’est celle de rappeler que le vouloir-vivre ensemble n’est pas (seulement) le fruit d’un positivisme normatif étriqué et réducteur. Les idées portent le monde ; la mission des sciences sociales est précisément de se faire le héraut d’un tel principe. En soulignant peut-être que magnifier par trop le passé fait injure à un présent qu’il nous appartient de construire, sans nous lamenter plus que de raison…
Publications 2023
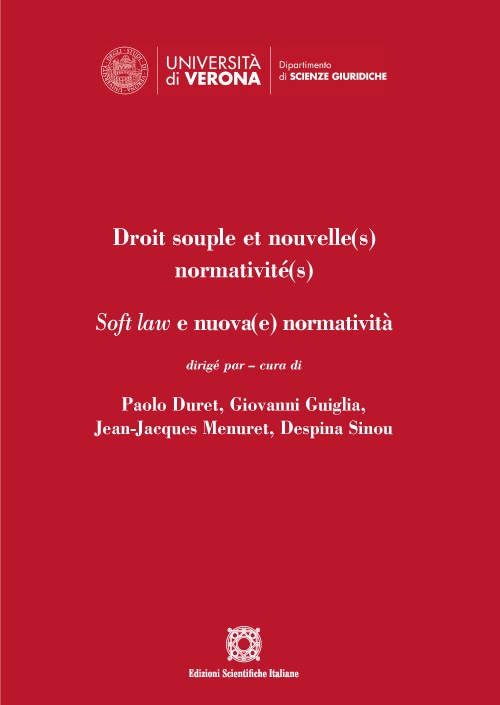 Droit souple et nouvelle(s) normativité(s) / Soft law e nuova(e) normatività
Droit souple et nouvelle(s) normativité(s) / Soft law e nuova(e) normatività
Parution de l’ouvrage intitulé « Droit souple et nouvelle(s) normativité(s) / Soft law e nuova(e) normatività », aux éditions Scientifiche Italiane.
Il rassemble les actes du colloque qui s’est tenu les 19 et 20 mai 2022 à l’Université de Vérone, dans le cadre des 3e journées d’études franco-italiennes entre le département de Science juridique de l’Université de Vérone et la Faculté de Droit, Sciences politiques et sociales de l’Université Sorbonne Paris Nord.
Publications 2020
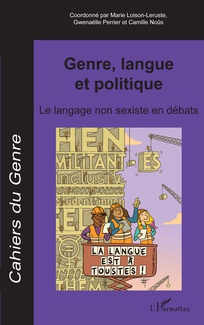 Genre, langue et politique. Le langage non sexiste en débats » dans les Cahiers du genre
Genre, langue et politique. Le langage non sexiste en débats » dans les Cahiers du genre
Sous la direction de Marie Loison-Leruste, Gwenaëlle Perrier et Camille Noûs, Editions l’Harmattan.
Prenant appui sur des controverses récentes, ce dossier réunit des contributions de disciplines différentes et interroge les mobilisations autour de l’usage du langage non sexiste dans plusieurs pays. En éclairant les conditions politiques et sociales d’émergence de ces débats publics, il montre que ceux-ci réactivent le clivage entre partisan·es et opposant·es à la transformation des normes de genre. Il met ainsi en lumière la dimension agonistique du langage.
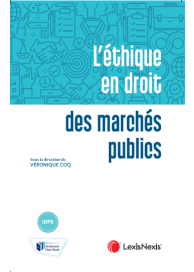 L’éthique en droit des marchés publics
L’éthique en droit des marchés publics
Sous la direction de Véronique Coq, aux Editions LexisNexis.
Publication des actes du colloque organisé le 29 novembre 2018 à l’université Paris 13
L’achat public a longtemps été considéré, pour l’essentiel, comme un acte juridique. Il était régi par le principe de neutralité visant à limiter les rapports des acheteurs publics avec l’action publique.
Aujourd’hui, la commande publique est davantage conçue comme « un acte économique » gagné par « la culture du résultat et de la performance ». L’achat public est utilisé comme un levier d’action au niveau européen pour stimuler la croissance et renforcer la confiance du citoyen-contribuable.
Il est devenu un outil majeur pour soutenir de nombreuses politiques publiques sectorielles.
Cette mutation a des répercussions profondes sur les fins du droit des marchés publics et sur les caractéristiques de l’achat dit éthique (celui qui tend à améliorer l’efficacité de l’action des pouvoirs publics). D’où la nécessité d’investir de nouveau le champ éthique qui ne se limite plus à la lutte contre la corruption mais s’étend bien plus loin au service d’autres missions d’intérêt général. Ce recueil, au travers des communications présentées, aborde donc l’éthique sous l’angle de l’architecture juridico-idéologique du droit des marchés publics.
Quel est le cadre idéologique sur lequel il repose ? Ce cadre permet-il sérieusement des avancées éthiques ? Plus précisément, le questionnement éthique impose de revenir sur les fondements des normes (valeurs/fonctions).
Il invite à mettre en lumière les principes matriciels sous-jacents afin de proposer une approche « critique » et prospective du fond du droit : penser le droit des marchés publics aujourd’hui et demain à travers de nouveaux paradigmes.
Ont contribué à l’ouvrage : Antoine BAILLEUX, Pierre BUGNET, Véronique COQ, Hugo DEVILLERS, Laurent FONBAUSTIER, Jonathan LACROIX, Franck LAFFAILLE, Joachim LEBIED, Jean-Jacques MENURET, Étienne MULLER, Emmanuel PICAVET, Charles REIPLINGER, Yann SIMONNET
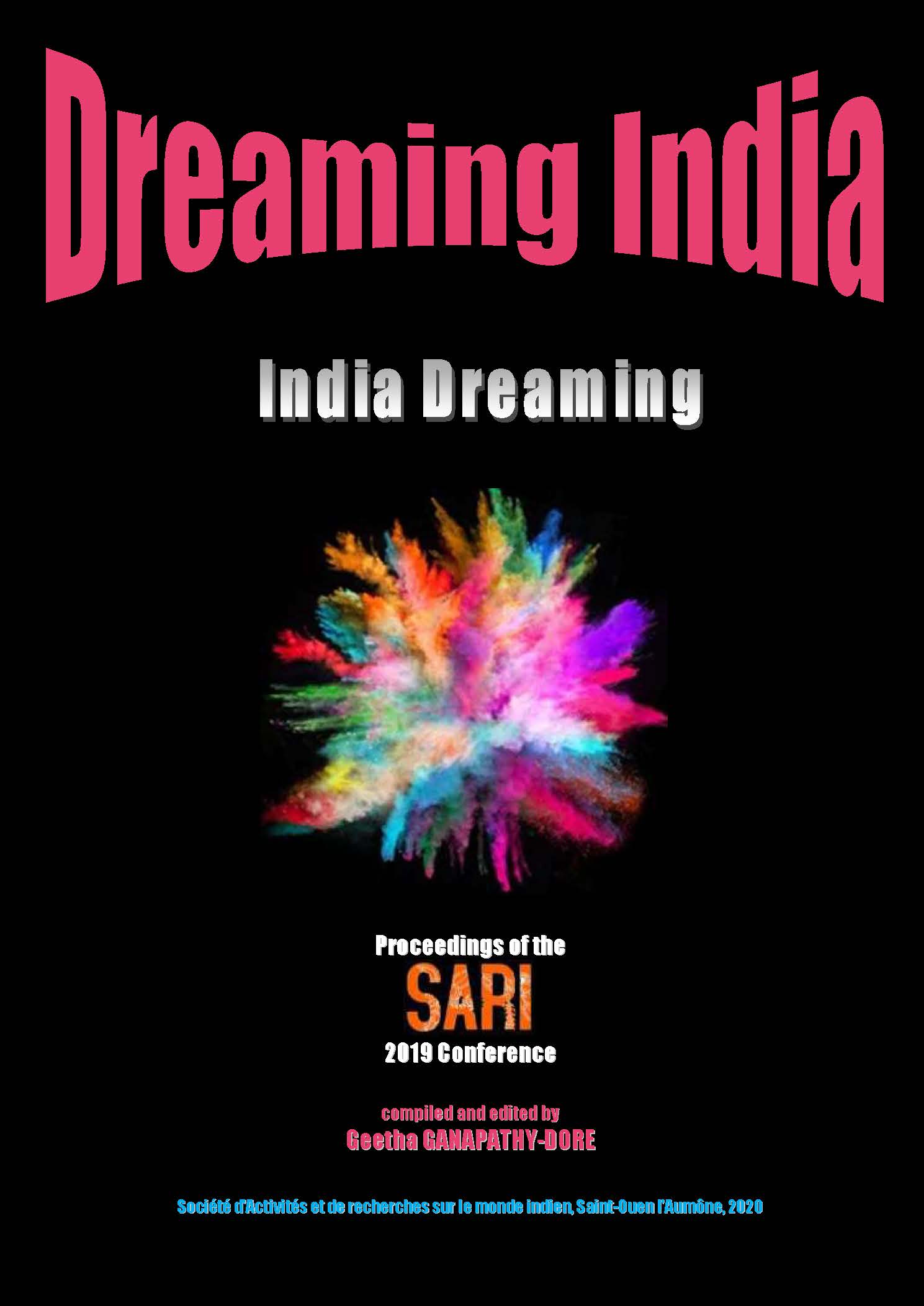 Rêves d’Inde/Rêver d’Inde
Rêves d’Inde/Rêver d’Inde
Publication des actes du colloque du SARI « Rêves d’Inde/Rêver d’Inde » en accès libre et déposé sur archives-ouvertes.fr.
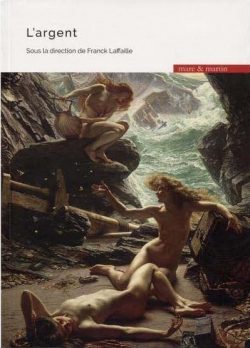 L’argent
L’argent
Sous la direction de Franck Laffaille, aux Editions Mare & Martin, collection “Bulletin Annuel de Villetaneuse, BAV”
Publication des actes du colloque organisé le 1er avril 2019 à l’université Paris 13
Résumé:
Etudes pluridisciplinaires sur le thème de l’argent abordé sous l’angle du droit, de la politique, de l’économie, de la sociologie, de la psychanalyse, de la littérature et de l’histoire.
 Global Commons
Global Commons
Une sélection d’articles issus du colloque conjoint organisé en novembre 2018 par l’Université de Paris 13 et l’université de Pondichéry sur les communs a été publiée par l’éditeur SAGE en anglais avec le titre Global Commons.
Avec les contributions de Didier GUEVEL, Julien CAZALA, Catherine FABREGOULE, Jean-Jacques MENURET et Geetha GANAPATHY-DORE
Sous la direction du Prof. Baskaran Mohanan Pillai (professeur invité la faculté de Droit en 2017) et Geetha Ganapathy-Doré.
La version kindle est disponible immédiatement sur la plateforme amazon.
Global Commons: Issues, Concerns and Strategies presents a comprehensive international perspective on the global commons—natural resource domains that are not subject to national jurisdictions and are accessible to all nations. These include the oceans, atmosphere and outer space, and specific locations such as Antarctica. Due to their critical importance in maintaining human lives and livelihoods, and their vulnerability to depletion, the collaborative preservation of the global commons is of great relevance to all human communities. Leading world powers, such as France, are increasingly adopting environmental policies as key to their functioning as democracies. After the Paris Climate Conference, there has been a spurt in cooperation between major nations, such as France and India, in the fight against climate change.
This book provides exhaustive coverage of all the major facets of preservation of the global commons. It will, therefore, prove indispensable to all stakeholders in a new, just and sustainable world order.
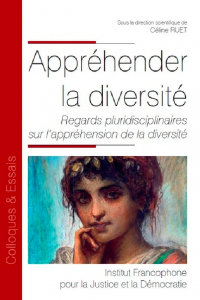 Appréhender la diversité. Regards pluridisciplinaires sur l’appréhension de la diversité
Appréhender la diversité. Regards pluridisciplinaires sur l’appréhension de la diversité
Sous la direction de Céline Ruet
Publication des actes du colloque organisé en octobre 2018 à la Maison de l’Europe, Paris
La conception démocratique de la société implique que la diversité soit perçue « non comme une menace mais comme une richesse », selon la Cour européenne des droits de l’homme, car le pluralisme « repose aussi sur la reconnaissance et le respect véritables de la diversité ». Notion à caractère flou, la diversité constitue une composante essentielle de la société démocratique et il importe en conséquence d’en préciser la nature, l’évolution et les contours. La nécessité de prendre la diversité en considération conduit à interroger le cadre normatif de l’appréhension de la diversité et à réunir des manières de voir qui prennent leurs sources dans différentes disciplines, droit, philosophie, anthropologie, sociologie, démographie. Dans quelles limites, selon quelles modalités, par quels instruments, l’appréhension de la diversité est-elle susceptible de s’opérer ? Quel(s) modèle(s) d’appréhension de la diversité retenir ? Quelle articulation entre universalité des droits de l’homme et prise en compte de la diversité ?
TÉLÉCHARGER LA PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE
 Réinventer la mer, précarité épistémologie et récits
Réinventer la mer, précarité épistémologie et récits
Actes du colloque qui s’est déroulé les 29 et 30 juin 2017.
Sept communications présentées au colloque ont été publiées en ligne par la revue de la SAES Angles : https://angles.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=1897
Publications 2019
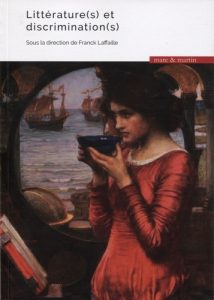 Littérature(s) et discrimination(s)
Littérature(s) et discrimination(s)
Actes de la 2ème journée du BAV (Bulletin annuel de Villetaneuse) coorganisé avec l’IRDA, le 29 mai 2018 à l’université Paris 13.
Publication aux Editions Mare et Martin, en octobre 2019 (Direction : Franck Laffaille)
Résumé : Qui mieux que la fiction littéraire est à même d’appréhender la discrimination en tant que révélateur de l’âme humaine ? La deuxième édition du Bulletin annuel de Villetaneuse (université Paris XIII) se penche sur le roman, palimpseste montrant combien les hommes construisent la figure de l’hostis, l’ennemi. Qu’il s’agisse de l’Afrique du sud au temps de l’apartheid, des Etats-Unis ségrégationistes, de l’Italie fasciste, de la France coloniale, de l’Inde des castes, d’une dystopie totalitaire…
émerge un bouc émissaire qui à raison de sa peau, de sa religion, de sa naissance, de son sexe – subit la négation de sa dignité. Les études recueillies dans cet ouvrage sont gouvernées par le principe de pluridisciplinarité, droit – politique et sociologie se croisant de manière féconde.
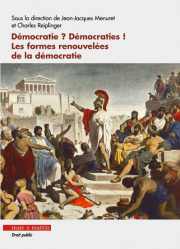 Démocratie ? Démocraties ! Les formes renouvelées de la démocratie
Démocratie ? Démocraties ! Les formes renouvelées de la démocratie
Actes du colloque qui s’est déroulé le 19 mai 2016.
Publication aux Editions Mare et Martin, en octobre 2019 (Direction: Jean-Jacques Menuret et Charles Reiplinger )
Avec les contributions de Emmanuel Aubin, Nicolas Clinchamps, Bernard Dolez, Nelly Ferreira, Didier Guevel, Ali El Hamine, Franck Laffaille, Jean-Jacques Menuret, Pierre-Yves Monjal, Charles Reiplinger et Xavier Souvignet.
Résumé : Il serait vain de chercher l’origine de la notion de démocratie, comme d’en proposer une seule définition, voire d’essayer d’en sérier toutes les manifestations. Sous ce terme se dessinent en réalité différentes formes d’exercice du pouvoir et donc de souveraineté du peuple, dont certaines sont plus persistantes, même si elles sont souvent renouvelées. Ainsi en est-il de la démocratie représentative, de la démocratie directe et de la démocratie participative. La première, qui constitue le modèle d’une conception universaliste, est souvent dite en crise, la deuxième est désirée mais peu appliquée, et la troisième, présentée comme un substitut ou un complément des deux autres, prendrait mieux en compte la diversité des citoyens. Nonobstant les débats, souvent d’ordre politique, sur les formes de la démocratie, il semble aujourd’hui que la notion les rassemble finalement toutes, dès lors qu’elles peuvent légitimer les institutions, les pouvoirs et les normes. Mais encore convient-il de s’assurer que la concurrence des formes n’affaiblisse pas la démocratie tout entière.
Publications 2018
 La Contitution face aux changements climatiques
La Contitution face aux changements climatiques
Actes du colloque coorganisé avec l’IRIS et la Structure Fédérative Développement Durable de l’Université Paris 13, le 8 mars 2018 à l’Assemblée Nationale.
Publication aux editions Lexis Nexis, dans la Revue Énergie, Environnement, Infrastructures, en décembre 2018 (Direction : Christel Cournil)
Résumé : Le contexte d’intensification de la lutte contre les changements climatiques a donné lieu à l’adoption d’une série d’instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux qui ont progressivement intégré « par capillarité » le droit français. La mise en oeuvre de l’Accord de Paris, des règlements et directives découlant du « Paquet sur le climat et l’énergie à l’horizon 2020 » et de son prolongement avec le « Cadre pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 » et l’adoption par Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition écologique et solidaire du Plan Climat en juillet 2017 conduit déjà et conduira à l’adoption de nouvelles dispositions susceptibles d’être examinées par le juge constitutionnel ou les juges ordinaires. Le droit constitutionnel sera au coeur des problématiques climatiques, dans les prochaines années, tant en raison des arbitrages possibles que sera amené à trancher le Conseil constitutionnel en amont par l’examen de la constitutionnalité de la loi ou en aval par les possibles questions prioritaires de constitutionnalité portées devant les juges ordinaires. Contrairement aux États-Unis et à l’Australie et d’autres pays du monde, la France connaît encore peu de « contentieux climatiques » 1. Les questions climatiques ne sont pas encore frontalement posées au juge français. Ceci peut s’expliquer pour de raisons multiples. D’abord, la France a été parmi les premiers pays à se doter des politiques climatiques plutôt ambitieuses notamment liées à l’atténuation des gaz à effet de serre (GES) même si sa planification climatique territoriale a été assez tardive. Ensuite, jusqu’ici très peu de recours contentieux portés par des associations de défense de l’environnement ont été intentés pour faire examiner les impacts des grands projets sur le système climatique. Enfin, certaines académies et associations estiment que le « cadre référentiel » de la Charte de l’environnement adoptée en 2005 n’offre pas sur le plan procédural et substantiel les conditions adéquates pour appréhender la complexité des enjeux climatiques et surtout ne permet pas de mettre en oeuvre une véritable justice climatique en France. Dès l’annonce d’une nouvelle réforme constitutionnelle par le Président Macron, certainesONGet députés ont très vite insisté sur la nécessité d’insérer la lutte climatique dans la norme suprême au nom de l’urgence climatique et de « l’ouverture » de l’office du juge national aux questions climatiques. Dans ce contexte, un colloque intitulé « la Constitution face aux changements climatiques » que nous avons organisé le 8 mars 2018 à l’Assemblée nationale a permis de réunir certains constitutionnalistes, environnementalistes, députés et membres de la société civile pour échanger de la pertinence ou non de s’engager vers un nouveau « verdissement » de la Constitution française. Ce dossier thématique restitue une partie des échanges ayant eu lieu lors de ce colloque. Il propose d’abord d’analyser spécifiquement les changements climatiques sous l’angle des normes constitutionnelles françaises. Stéphane Mouton y présente ainsi les enjeux constitutionnels liés aux changements climatiques en s’interrogeant sur ce nouvel objet politique. Sont ensuite retracés le contexte de ce nouveau processus de verdissement constitutionnel, les grandes lignes des discussions parlementaires en s’appesantissant sur les aspects retenus ou non dans la future loi de révision constitutionnelle (Christel Cournil). Par ailleurs, ce dossier vise à sortir du cadre franco-français et adopte une approche comparée de la constitutionnalisation de la lutte climatique. Les constitutionnalistes Laurence Gay et Marthe Fatin-Rouge Stefanini présentent une synthèse de l’utilisation de la Constitution dans les contentieux climatiques en Europe et en Amérique du Sud. Les chercheurs Géraud de Lassus Saint- Geniès et Sébastien Jodoin exposent, quant à eux, ce que les droits constitutionnels pourraient apporter en matière d’adaptation au changement climatique au Canada. Puis, ce dossier liste les principaux arguments juridiques et philosophiques en faveur d’un nouveau « verdissement » de la Constitution Française défendue par le philosophe Dominique Bourg et le Professeur émérite de droit public Michel Prieur à travers leur souhait de voir inscrire, à la fois, les limites planétaires et le principe de non régression dans l’article 1er de la Constitution française. Ce dossier se termine, enfin, par les libres propos conclusifs de Marie Toussaint, Présidente de l’Association Notre Affaire à tous qui va déposer le premier « recours climat » en France.
 Le juge et les nouvelles formes de démocratie participative
Le juge et les nouvelles formes de démocratie participative
Actes du colloque coorganisé avec l’Université de Vérone, le 7 juin 2018 à Vérone.
Publication en novembre 2018 (Direction : Paolo Duret, Giovanni Guiglia, Jean-Jacques Menuret et Despina Sinou)
Giovanni Guiglia, Avant-propos/Prefazione Frank Laffaille, La démocratie participative, ou l’adjectif « sans qualité ». Contre « la politica dell’aggettivo » Jean-Jacques Menuret, Autorités administratives indépendantes (AAI) et démocratie participative : quel(s) modèle(s) ? Despina Sinou, La justiciabilité du droit de participation citoyenne dans la pratique des organes juridictionnels et conventionnels internationaux et européens Stefano Catalano, Il giudice costituzionale italiano di fronte alle sfide della democrazia partecipativa Jacopo Bercelli, Il giudice amministrativo italiano e le nuove forme di democrazia partecipativa Sergio Moro, Autorità amministrative e democrazia partecipativa in Italia: quale(i) modello(i)? Neliana Rodean, La ‘giustiziabilità’ del diritto di partecipazione dei cittadini nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea Paolo Duret, Conclusion
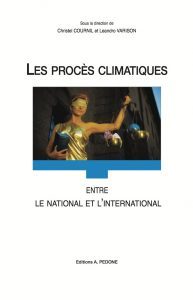 Les procès climatiques. Entre le national et l’international
Les procès climatiques. Entre le national et l’international
Publication aux Editions A. Pedone en octobre 2018 (Direction : Christel Cournil et Leandro Varison)
Résumé : Le droit international du climat a conduit les États du monde entier à adopter, depuis les années 2000, des lois portant sur la réduction et l’adaptation aux changements climatiques. Comme résultat de ce phénomène d’internalisation du droit international, des droits et obligations ont été progressivement affirmés au niveau domestique et invoqués par des acteurs très différents devant les tribunaux nationaux : soit pour contester leurs contenus (trop ou pas assez exigeants), soit pour enjoindre à l’État ou ses autorités d’aller plus ou moins loin (selon les requérants) et d’être plus ambitieux dans la planification des objectifs climatiques, ou encore afin d’engager la responsabilité des entreprises polluantes. Depuis, ce contentieux climatique s’est considérablement déployé tout en se diversifiant, d’abord aux États-Unis, mais désormais aussi en Europe et dans le reste du monde. Le procès climatique constitue un ensemble très hétérogène : des recours administratifs à la saisine des instances internationales et régionales, engageant la responsabilité d’une agence régionale ou d’un vaste groupe d’entreprises multinationales, demandant des réparations pour une seule victime ou pour un peuple entier, invoquant des impacts climatiques passés ou la violation des droits des générations futures. Les thématiques traitées dans ces procès sont vastes, abordant aussi bien la réglementation du droit climatique (mesures de réduction des gaz à effet de serre ou des mesures d’adaptation), que du droit de la responsabilité de l’État et de l’entreprise, soit par le droit civil ou le droit administratif. Les argumentaires des requérants mobilisent les notions de common law (Law of torts, Public Trust), les droits fondamentaux, les droits constitutionnels, le droit de l’environnement, mais aussi le droit des investissements, le droit des affaires, et ce à toutes les échelles internationale, régionale, nationale ou locale. Cet ouvrage a pour ambition d’analyser la complexité des procès climatiques mais aussi les enjeux essentiels pour le droit et pour les juridictions soulevés par ce contentieux encore émergent. Il constitue en grande partie des restitutions de certaines communications du premier colloque international sur les contentieux climatiques qui a eu lieu le 3 novembre 2017 à Paris. L’ouvrage est complété de contributions de spécialistes des contentieux climatiques et environnementaux. Il offre un regard croisé d’académiques, chercheurs, praticiens, avocats et juristes des organisations non gouvernementales, et présente une variété de points de vue et d’éléments de langages sur les procès climatiques tant sur le plan formel que substantiel, nécessaire pour appréhender les enjeux complexes.
 Utopies
Utopies
Actes de la 1ère journée du BAV (Bulletin annuel de Villetaneuse) coorganisé avec l’IRDA, le 16 mai 2017 à l’université Paris 13.
Publication aux Editions Mare et Martin en Août 2018 (Direction : Franck Laffaille).
Résumé : La première journée du BAV (Bulletin annuel de Villetaneuse) est dédiée aux utopies, dans un cadre pluridisciplinaire associant les trois laboratoires de la Faculté de droit (CERAP, CERAL, IRDA). Droit public, droit privé, histoire du droit et sociologie se retrouvent pour décliner, à l’aune de leur champ disciplinaire, le thème choisi. L’utopie est appréhendée au regard de l’histoire politique et constitutionnelle, qu’il s’agisse de la relation entre utopie et Constitution, du concept de Res Publica durant la République romaine, de la souveraineté du genre humain sous la Révolution française. L’utopie s’entrevoit encore à l’aune du droit de l’Union européenne, avec la quête d’une défense européenne et le développement de la libre circulation des personnes. Le monde de l’immatériel n’est pas absent de la quête utopique, qu’il s’agisse du secret dans le cyberespace ou des perspectives numériques de la démocratie. Quant au droit administratif et au droit privé, ils s’interrogent respectivement sur la dimension – utopique ? – d’un statut général des autorités administratives indépendantes et l’existence d’une économie sociale et solidaire en droit des affaires. Enfin, une ultime réflexion imagine ce que seraient nos facultés de droit si l’utopie venait à se cristalliser et embrasser le réel académique.
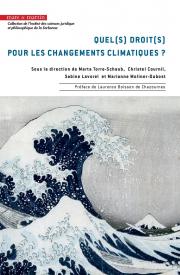 Quel(s) droit(s) pour les changements climatiques ?
Quel(s) droit(s) pour les changements climatiques ?
Actes du colloque coorganisé avec l’IRIS et la Structure Fédérative Développement Durable de l’Université Paris 13 et l’Université Paris 1, le 31 mars 2017 à l’Université Paris 1.
Publication aux Editions Mare et Martin, collection “Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne” en mars 2018 (Direction : Christel Cournil, Marta Torre-Schaub, Sabine Lavorel, Marianne Moliner-Dubost)
Résumé : Les changements climatiques lancent un défi au droit que nul ne peut aujourd’hui ignorer. Face aux enjeux soulevés par ces bouleversements environnementaux majeurs, le cadre juridique ne peut rester immuable, et les sciences juridiques, comme l’ensemble des autres disciplines scientifiques, doivent y participer. L’ouvrage Quel(s) droit(s) pour les changements climatiques ?, issu des actes du premier colloque du Réseau Droit et Changement Climatique, qui s’est tenu à Paris le 31 mars 2017, a pour objectif de s’interroger sur les rapports réciproques qu’entretiennent le droit et les changements climatiques. Il réunit dans cette perspective les contributions de juristes de différentes spécialités (environnementalistes, internationalistes, privatistes, constitutionnalistes, fiscalistes, urbanistes) qui analysent l’émergence d’un “droit des changements climatiques” et interrogent sa pertinence. L’étude, à la fois critique et prospective, s’opère à partir d’une double démarche : en examinant ce que le droit peut apporter pour améliorer la lutte contre les changements climatiques tout en observant, en retour, les évolutions ou les mutations que la problématique climatique induit dans le droit. Partant de ces questionnements, l’ambition commune des auteurs est de mettre en exergue l’originalité et la complexité du processus d’élaboration de ce “nouveau droit”.
Publications 2017
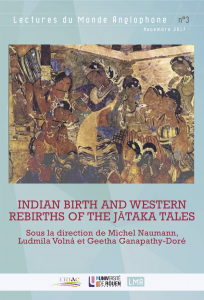 Indian Births and Western Rebirths of the Jataka Tales
Indian Births and Western Rebirths of the Jataka Tales
Actes du colloque de la SARI ( Sociétés d’Activités et de Recherches sur les mondes Indiens) coorganisé avec le CREA de l’Université de Nanterre, les 26, 27 et 28 mai 2016
Publication dans la Collection Lectures du Monde anglophone (ERIAC, Université de Rouen Normandie), en novembre 2017 (Direction : Michel Naumann, Ludmila Volná et Geetha Ganapathy-Doré)
Résumé : This article explores the early history of the jātaka genre and opens up some questions about its relation to other bodies of pre-modern Indian literature. It asks to what extent a jātaka can be defined, how jātakas functioned within early Buddhist communities, and how their particular generic conventions allowed for both distinctively Buddhist perspectives and the inclusion of wider Indian narrative motifs. The article also touches upon the relationship between jātaka literature and other early Indian narrative texts, such as Jain scriptures and the Hindu Mahābhārata.
Publication
Publications 2016
 Droit public et droit privé de l’environnement: unité dans la diversité ?
Droit public et droit privé de l’environnement: unité dans la diversité ?
Actes du colloque coorganisé avec l’IRDA et la Structure Fédérative Développement Durable de l’Université Paris 13, le 12 juin 2015 au Palais du Luxembourg.
Publication aux Editions LGDJ collection Grands Colloques, en décembre 2016 (Direction : Eric Naïm-Gesbert et Mustapha Mekki).
Résumé : La présente publication est le fruit d’un colloque intitulé Droit public et droit privé de l’environnement : unité dans la diversité?, organisé au Sénat. Cet ouvrage est l’occasion de croiser les regards des juristes privatistes et publicistes autour des questions fondamentales qui irradient cette « discipline ». L’objectif a été de dépasser les frontières pour penser ou repenser les problématiques du droit de l’environnement. Cette approche dualiste s’impose d’autant plus que ce droit apparaît davantage comme une « transdiscipline ». La question environnementale du début du XXIe siècle succède ou s’adjoint aujourd’hui à la question sociale du début du XXe. Pour faire état de ce droit qui se joue des catégories et des classifications traditionnelles, les organisateurs ont choisi d’aborder plusieurs piliers de ce temple environnemental en distinguant, en trois temps, les principes, les droits et les techniques. Cet ouvrage est une boîte à outils et un décodeur offrant les moyens d’une relecture plus claire et plus pertinente du droit privé et du droit public de l’environnement. Il s’adresse tant aux praticiens (avocats, notaires, experts ) qu’aux universitaires et étudiants confrontés aux questions environnementales.
 L’écologie Politique
L’écologie Politique
Actes du colloque du 12 novembre 2015 à l’Institut des Amériques.
Publication aux Editions l’Harmattan, Revue française des idées politiques, n° 44, en décembre 2016
Résumé : La question écologique est aujourd’hui inscrite dans tous les agendas politiques. Aucun parti, aucun mouvement, aucune religion instituée ne saurait faire l’économie d’une réflexion sur ce sujet. Il est ainsi apparu stimulant de revenir sur le genèse de la pensée écologique, sur ses prolongements et ses enjeux politiques – notamment en France – dans la seconde moitié du XXe siècle.
 Sécurité et environnement
Sécurité et environnement
Actes du colloque coorganisé avec l’IRIS de l’Université Paris 13, le 8 juin 2015 à l’EHESS.
Publication aux Editions Bruylant, en octobre 2016 (Direction : Nicolas Clinchamps, Christel Cournil, Catherine Fabregoule et Geetha Ganapathy-Doré)
Résumé : Fruit des débats organisés à Paris lors du colloque international du 8 juin 2015, l’objet de cet ouvrage vise à mettre en lumière la complexité des liens entre « sécurité et environnement », au regard de l’évolution de la notion de sécurité environnementale sous l’angle des sciences juridiques, politiques et de l’anthropologie. Traçant les contours et soulignant le potentiel du concept de sécurité environnementale, ces nouvelles pistes de réflexions débutent par un cadrage théorique du lien entre cette notion complexe et le droit de l’environnement (Titre 1). Si les sociétés humaines ont acquis et développent aujourd’hui des capacités réactives et d’adaptation inédites face aux crises, le monde du début du XXe siècle est aussi caractérisé par un sentiment de vulnérabilité lié aux changements environnementaux globaux, aux enjeux géopolitiques de l’énergie, aux crises multiformes concernant l’accès aux ressources et, d’une manière globale, aux problèmes de sécurité humaine. Tous ces sujets se retrouvent à différentes échelles : internationale (Titre 2), européenne (Titre 3) et régionale ou encore locale (Titre 4). Sont ensuite abordées les différentes sécurités environnementales en offrant un panel illustratif et non exhaustif de thèmes aussi importants que les changements climatiques, la sécurité énergétique (gaz de schiste), la biosécurité et la forêt, auxquels s’ajoute une réflexion sur les ravages environnementaux des politiques sécuritaires antidrogues (Titre 5). Enfin, les obligations plus ou moins assumées de l’État – prévention, action ou inaction – interrogent la sécurité environnementale. Une réflexion est alors engagée sur le lien entre ses exigences et celles de la sécurité nationale (Titre 6).
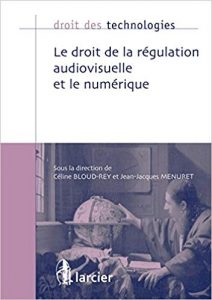 Le droit de la régulation audiovisuelle et le numérique
Le droit de la régulation audiovisuelle et le numérique
Actes des 2 demi-journées d’étude coorganisées avec l’IRDA de l’Université paris 13 et le Labex ICCA, les12 décembre 2014 et 16 janvier 2015 au Palais du Luxembourg.
Publication aux Editions Larcier, en août 2016 (Direction : jean-Jacques Menuret et Céline Bloud-Rey)
Résumé : Le droit de l’audiovisuel a connu depuis plus d’une vingtaine d’années de nombreuses transformations pour s’adapter aux évolutions que connait le secteur et répondre aux besoins croissants de régulation. L’apparition et le développement du numérique dans les différents médias a sans doute accéléré les besoins de réforme de la régulation de l’audiovisuel, compte tenu de la convergence constatée entre les deux domaines. Plusieurs lois se sont ainsi succédé en France pour essayer de rendre compte de cette évolution par petites touches successives, sans toutefois remettre en cause en profondeur le dispositif mis en place par la loi du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication. L’adoption des deux lois du 15 novembre 2013, relative à l’indépendance de l’audiovisuel public annonce peut-être un bouleversement à venir. En effet, elles remodèlent à beaucoup d’égards l’organe français de régulation de l’audiovisuel, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), dont le statut et les procédures sont revues, mais ne le dotent que de rares pouvoirs nouveaux, alors pourtant que les besoins de régulation du secteur sont indéniables. Ce faisant, elles anticipent assurément la réforme à venir, et combien plus difficile, de l’audiovisuel lui-même. Sa redéfinition est en effet nécessitée par la prise en compte de sa convergence croissante avec le numérique (le développement de nouvelles techniques et de nouveaux services aux frontières communes, tels les services de médias audiovisuels à la demande) et le constat que la régulation de ce dernier est déjà éclatée en France entre plusieurs organismes publics autres que le CSA (ANFR, ARCEP, ADLC, HADOPI, notamment), sans oublier évidemment l’influence croissante du droit européen en la matière. C’est sur tous ces aspects et les interrogations qu’ils font naître, que les contributions réunies dans cet ouvrage entendent réfléchir.
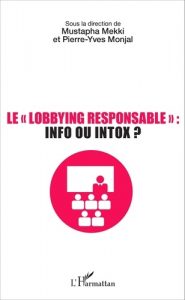 Le « lobbying responsable » : info ou intox ?
Le « lobbying responsable » : info ou intox ?
Actes du colloque coorganisé avec l’IRDA et la Structure Fédérative Développement Durable de l’Université Paris 13 et le GERCIE de l’Université de Tour, le 28 avril 2014 au Sénat.
Publication aux Editions l’Harmattan, en février 2016 (Direction : Pierre -Yves Monjal et Mustapha Mekki)
Résumé : Perçu avec suspicion, le lobbying est une entrave à la démocratie et une menace pour lintérêt général. Or faire du lobbying, cest certes défendre des intérêts catégoriels mais cest surtout apporter aux producteurs de la norme juridique une expertise précieuse. Faisant état de cette place accordée aux lobbies, cette étude se propose dapprécier leur légitimité. Les réponses étant variables selon langle de vue, cet ouvrage analyse ce phénomène afin de déterminer si le lobbying dit « responsable » relève de linfo ou de lintox.
Publications 2015
 Doctrine publiciste et droit romain
Doctrine publiciste et droit romain
Actes du colloque organisé le 27 février 2014 au Conseil supérieur du notariat.
Publication dans la Revue française d’histoire des idées politiques n°41, aux Editions l’Harmattan, en mai 2015 (Direction : Erci Desmons)
Résumé : Si la culture romaniste de la doctrine privatiste classique est une évidence, elle semble l’être moins dans le monde des juristes de droit public. Pourtant, pour des raisons qui tiennent à leur formation, les publicistes sont tout autant redevables au droit romain. Les contributions réunies dans ce numéro tentent d’évaluer l’ampleur, le sens et la profondeur de l’empreinte du droit romain et des institutions romaines dans la doctrine du droit public.
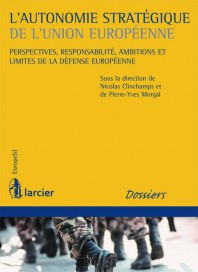 L’autonomie stratégique de l’Union européenne
L’autonomie stratégique de l’Union européenne
Acte du colloque coorganisé avec le GERCIE de l’Université de Tour, le 8 novembre 2013 au Conseil supérieur du notariat.
Publication aux Larcier, Collection “Europe(s)” en janvier 2015 (Direction : Nicolas Clinchamps et Pierre-Yves Monjal)
Résumé : Faute d’autonomie, la défense européenne a-t-elle un sens ? Quasi-absente des conflits libyen en 2011 et malien en 2012/2013, elle symbolise plus que jamais les errements de la construction de l’Europe politique. À l’origine, le plan Schumann du 9 mai 1950 fit le pari du long terme : « L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait ». Il fallut dans un premier temps préserver la paix en fédérant l’économie de la guerre. Concrétisé par le Traité CECA, du 18 avril 1951, ce début de construction fédérale à l’envers ouvrit la voie aux négociations du Traité CED. Après l’amorce économique, ce passage, sans doute trop hâtif, à l’Europe politique fut rejeté par le Parlement français en 1954. La construction européenne resta longtemps orpheline de sa défense. Mais, au début des années 1990, la guerre des Balkans constitua une nouvelle menace au coeur même du Vieux continent et imposa la relance du projet de défense européenne. Devenue réalité, la PSDC s’affirme au travers de ses multiples opérations civiles et militaires. Pourtant, elle peine encore à s’imposer. Sujet crucial et paradoxalement méconnu, la défense européenne soulève de multiples questions. Cet ouvrage dresse le bilan et offre autant de pistes de réflexion pour tenter d’y répondre. L’ouvrage intéresse les cadres et les dirigeants d’entreprise, les consultants et les experts en stratégie, ainsi que les fonctionnaires spécialisés dans la défense, l’armement et l’Union européenne.
Publications 2013
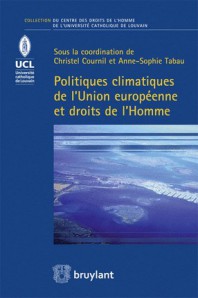 Politiques climatiques de l’Union européenne et Droits de l’homme
Politiques climatiques de l’Union européenne et Droits de l’homme
Publication aux Editions Bruylant, Collection “Collection du Centre des droits de l’homme de l’Université catholique de Louvain”, en octobre 2013 (Direction : Christel Cournil et Anne-Sophie Tabau).
Résumé : Le lien « droits de l’Homme et changements climatiques » présente un double aspect. D’une part, les changements climatiques portent atteinte aux droits de l’Homme par leurs effets néfastes sur certaines populations (droit à la vie, droit à l’alimentation, droit à l’eau, droit à la santé et au logement). La difficulté consiste alors à établir un lien direct entre les nuisances imputées aux changements climatiques et les actes ou omissions de certains États. D’autre part, les mesures d’atténuation (mitigation) et d’adaptation aux changements climatiques peuvent être attentatoires aux droits de l’Homme. Ces mesures peuvent générer des « effets secondaires » dommageables sur certaines populations qui ne sont pas toujours prises en compte dans les politiques conduites. C’est donc le contenu de la politique climatique présente et future qui est ici visé et particulièrement ses conséquences à court ou long terme sur les populations vulnérables. Ce lien « droits de l’Homme et changements climatiques » est au coeur des nouvelles compétences de l’Union européenne. Sa gouvernance et ses actions futures face à ces défis sont de différentes natures : juridiques, politiques, diplomatiques, financières, techniques et démocratiques. Les exigences en termes de droits de l’Homme impliquent une politique climatique de l’Union européenne plus transparente, mais aussi plus équitable, afin de favoriser l’acceptation des efforts à accomplir pour réformer les modes de vie, de production et de consommation vers un développement durable pour tous. Parallèlement, l’enjeu climatique suppose une interprétation évolutive, modernisée et volontariste des droits de l’Homme, afin qu’émerge un véritable droit à l’environnement, dont les corollaires comprendraient le droit à l’énergie durable, aux services publics relatifs à la mobilité ou encore à l’habitat vert et efficace sur le plan énergétique.
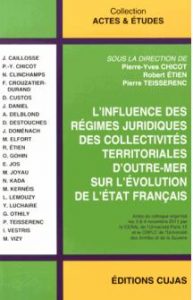 L’influence des régimes des collectivités territoriales d’outremer sur l’évolution de l’Etat français
L’influence des régimes des collectivités territoriales d’outremer sur l’évolution de l’Etat français
Publication aux Editions Cujas en octobre 2013 (Direction : Pierre-Yves Chicot, Robert Etien et Pierre Teisserenc)
Résumé : Etat unitaire, par opposition au modèle fédéral, la France est aussi un Etat décentralisé où les collectivités territoriales de droit commun côtoient des collectivités territoriales à statut dérogatoire (Paris, Corse, Alsace-Moselle) et des collectivités territoriales à régime juridique particulier comme celles de l’outre-mer. Or, ces dernières ont vu leur statut sensiblement modifié, notamment depuis la réforme constitutionnelle de 1998, puis celles de 2003 et 2008, en faveur de formules juridiques adaptées aux particularismes de leurs territoires et populations, plus ou moins proches du droit commun de la métropole. Partant, une question – que d’aucuns pourraient considérer comme iconoclaste – peut désormais se poser : serait-il possible, dans le cadre général du débat sur la décentralisation, de considérer les différentes réformes qui ont concerné l’outre-mer comme autant d’expérimentations propres à stimuler la réflexion sur les rapports entre l’Etat et l’ensemble des collectivités territoriales ?
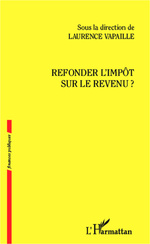 Refonder l’impôt sur le revenu
Refonder l’impôt sur le revenu
Actes du colloque du 20 janvier 2012.
Publication aux Editions l’Harmattan, en juillet 2013 (Direction : Laurence Vapaille).
Résumé : L’impôt sur le revenu reste d’actualité, dans le cadre d’une réflexion sur notre système fiscal et sur les choix politiques encore possibles malgré la crise économique et financière qui impose ses contraintes. Quatre axes de réflexion en lien avec la refondation de l’imposition sont ici proposés : la notion de justice fiscale, les “niches” fiscales, l’évolution de la progressivité de l’impôt et la prise en compte de la famille face aux profonds changements qui la bouleversent.
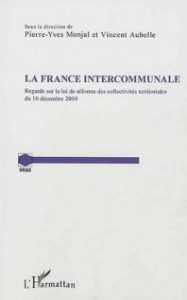 La France intercommunale
La France intercommunale
Actes du colloque organisé les 27 et 28 avril 2011.
Publication aux Editions l’Harmattan, en avril 2013 (Direction : Pierre-Yves Monjal et Vincent Aubelle).
Résumé : Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) constituent des modes d’organisation des territoires ruraux et urbains spécifiques. La loi n° 2012-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales comprend un volet intercommunal conséquent qui contribue à renforcer la présence de ces structures tout en procédant à l’amélioration de leur mode de fonctionnement. La question qui peut légitimement être posée est celle de savoir si le mode intercommunal ou communautaire ne constitue pas un procédé subtil de réforme irréversible de la décentralisation telle que la France l’a conçue et pratiquée jusqu’alors. En d’autres mots, les communautés de communes, d’agglomération et urbaines et autres métropoles ne vont-elles pas porter un coup définitif à l’organisation décentralisée de la République bâtie sur les trois niveaux de collectivités que l’on connaît ? La France n’est-elle pas sur le point de changer de mode de gouvernance locale en recourant à des procédés politiques et juridiques fondés sur les notions de communautarisation, de mutualisation, de territoires pertinents, de développement économique, etc. ? C’est à cette série de réflexions que l’ouvrage ambitionne de répondre. Les vingt-deux contributions ici réunies donneront aux lecteurs de ce livre les moyens de penser la France intercommunale de demain.
Publications 2012
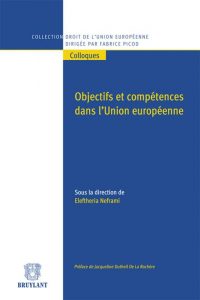 Objectifs et compétences dans l’Union européenne
Objectifs et compétences dans l’Union européenne
Actes du colloque du 10 décembre 2010.
Publication aux Editions Bruylant en décembre 2012 (Direction : Elefthéria Néframi).
Résumé : Le présent ouvrage propose une réflexion sur le rapport entre objectifs et compétences dans l’Union européenne en tant que corollaire du principe d’attribution et sous l’angle de l’autonomisation des objectifs. Dans une première partie, les auteurs abordent les objectifs assignés à l’Union européenne comme pierre angulaire de la répartition verticale et horizontale des compétences. D’un point de vue vertical, les objectifs constituent la référence pour l’exercice des compétences attribuées et ne sauraient être interprétés au-delà de celles-ci. D’un point de vue horizontal, les compétences ne sauraient être conçues indépendamment des objectifs au profit desquels elles ont été attribuées, au risque d’enfreindre le principe de spécialité. Cependant, le rapport entre objectifs et compétences ne se limite pas au parallélisme. Dans une deuxième partie, les auteurs abordent les objectifs au-delà des compétences. Les objectifs généraux qui ne correspondent pas à des compétences spécifiques peuvent être identifiés explicitement dans les traités ou résulter de la jurisprudence comme inhérents à l’objectif final d’intégration. De tels objectifs interviennent dans le champ des compétences et objectifs sectoriels, en tant qu’axe de développement des principes régulateurs de l’exercice des compétences. Le dépassement du rapport objectif-compétence est à constater également au sein des objectifs précis, objectifs-valeurs ou objectifs qui régulent l’exercice des compétences autres que celles qui auraient pu leur correspondre. La dynamique des objectifs, inhérente à une interprétation finaliste, structure ainsi l’ordre juridique de l’Union européenne et confirme son autonomie.
 La collégialité, valeurs et significations en droit publics
La collégialité, valeurs et significations en droit publics
Actes du colloque du 19 novembre 2010.
Publication aux Editions Bruylant en octobre 2012 (Direction : Jean-Jacques Menuret et Charles Reiplinger).
Résumé : La collégialité est souvent étudiée par les juristes dans sa relation au juge et au procès. Elle s’inscrit pourtant dans un cadre plus large, celui de la nécessité d’une certaine discussion dans l’élaboration des normes, non seulement des décisions de justice. La collégialité gouvernementale, la discussion parlementaire, les juridictions et autorités collégiales, seraient hier comme aujourd’hui autant de manifestations d’un principe fondamental de délibération, dont la collégialité serait la traduction organique. La collégialité serait ainsi une valeur fondamentale de la démocratie. Toutefois, il revient de constater que la consécration de la collégialité en tant que principe juridique, dans les différentes branches du droit public, interne et européen, ne va pas d’elle-même. L’absence de consistance certaine, comme de reconnaissance au plus haut niveau dans la hiérarchie des normes, en font plus une pratique suivie qu’un véritable principe. Les valeurs et significations juridiques de la collégialité sont ici abordées par des spécialistes (enseignants-chercheurs, membres du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État) de droit constitutionnel, droit administratif et droit européen.
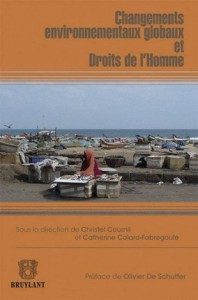 Changements environnementaux globaux & droits de l’homme
Changements environnementaux globaux & droits de l’homme
Publication aux Editions Bruylant en juin 2012 (Direction : Catherine Fabregoule et Christel Cournil).
Cette publication a donné lieu à un colloque les 27 et 28 septembre 2012.
Résumé : Cet ouvrage, regroupant la participation de trente spécialistes, analyse la pertinence d’une approche « droit de l’Hommiste » des changements environnementaux globaux en interrogeant les questions de justice et de responsabilité environnementale ainsi que celle des droits des générations futures et de l’affirmation d’un principe de non régression en matière de protection de l’environnement (Partie 1). Les conditions d’émergence des droits de l’Homme à l’environnement, ainsi que les principaux « artisans » de cette émergence, les contenus de ces droits selon les systèmes juridiques, leurs portées, leurs interactions positives ou négatives avec les autres droits humains, mais aussi leurs interdépendances et leur théorisation y sont présentés (Partie 2). Le lien entre la protection de l’environnement et certains droits « vitaux » de la personne humaine tels que : le droit à la vie, à la dignité, à la santé et à l’eau est mis en évidence. Des études établissent également des liens entre droits de l’Homme et les problématiques nouvelles du droit à l’alimentation et des droits de l’Homme en cas de catastrophes écologiques (Partie 3). L’approche « droit de l’Hommiste » met l’accent sur l’impact des changements environnementaux globaux sur la vie et donc sur les droits de certaines populations vulnérables, tels que les communautés locales, les peuples autochtones ou les personnes déplacées en raison de leur environnement dégradé ou menacé. Elle appelle la participation et l’appropriation de ces questions par les populations, afin de sauvegarder leurs droits (Partie 4).
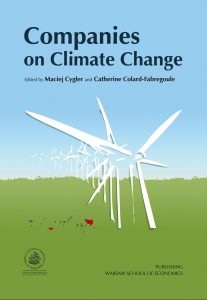 Companies and Climate change
Companies and Climate change
Actes du colloque des 7 et 8 avril 2011
Publication aux Editions Warsaw Law School Publishers en Janvier 2012 (Direction : Catherine fabregoule et Maciej Cygler).
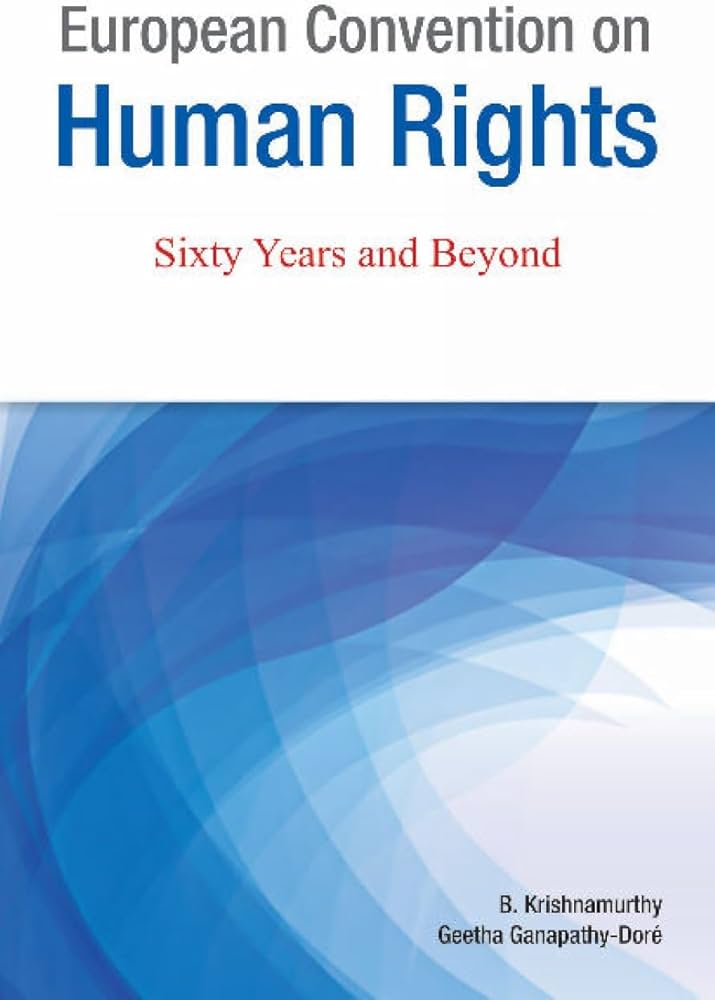 European Convention on Human Rights – Sixty years and Beyond
European Convention on Human Rights – Sixty years and Beyond
NC, New Century Publications, Inde en janvier 2012 (Direction : Geetha Ganapathy-Doré B. Krishnamurthy)
Résumé : Cet ouvrage collectif tente d’établir un bilan du régime des droits de l’homme européen instauré il y a soixante ans sous les auspices du Conseil de l’Europe. Les juristes européens ont essayé d’amender, critiquer et mettre en cause ce système afin de promouvoir et protéger les droits fondamentaux , toujours dans le but de les renforcer. L’ouvrage se penche sur les leçons que l’Europe et d’autres pays peuvent tirer de cette histoire à la fois riche et stimulante. Les contributions d’universitaires indiens et européens abordent les différents aspects de cette expérience et de ses conséquences. Avec la participation de : Pierre-Yves Monjal, Charles Reiplinger, Dominique Hiebel, Robert Etien et Geetha Ganapathy-Doré de la Faculté de droit de l’Université Paris 13.
Publications 2011
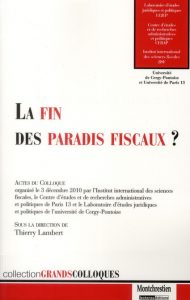 La fin des paradis fiscaux ?
La fin des paradis fiscaux ?
Actes du colloque du 3 décembre 2010
Publication aux Editions LGDJ / Montchestien – Collection Les Grands colloques, en novembre 2011 (Direction : Thierry lambert)
Résumé : Dans le contexte de la crise économique mondiale, c’est sous la contrainte politique des pays du G20 et sous les yeux de l’opinion publique internationale qu’un certain nombre de pays a accepté le principe de la transparence et de l’échange de renseignements à des fins fiscales.Dans cette perspective des États et territoires ont été conduits à signer des conventions fiscales internationales, ou des avenants, visant à renforcer l’échange d’informations. Toutefois tous les États, même ceux qui se veulent les plus vertueux, souhaitent attirer les capitaux du monde entier et retenir ceux qui s’y trouvent. Pour ce faire ils mettent en place des dispositifs sophistiqués qui ne sont pas toujours compatibles avec le souci de transparence. Les pays émergeants, mais aussi l’Algérie, l’Allemagne et la Suisse pour ne citer qu’eux, sont confrontés à cette problématique et ont donné des réponses différentes. Le forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (OCDE) publie régulièrement les examens par les pairs des cadres législatifs et réglementaires des différentes juridictions. L’une des questions qui se pose est de savoir si l’OCDE, ou une autre organisation internationale, peut aller au-delà d’une politique de transparence et d’échanges d’informations à des fins fiscales. Le secret bancaire s’est lézardé. Mais il est illusoire de penser que le seul critère de la transparence permet d’en terminer avec les paradis fiscaux. Les États, les investisseurs, les opérateurs économiques s’adaptent et s’adapteront aux nouvelles contraintes. Peut-être est-il temps de poser d’autres critères que le seul échange de renseignements, pour définir et lister les paradis fiscaux, qualifiés pour l’occasion de juridictions non coopératives.
Publications 2010
 De l’éminente dignité des juges… Autour de ‘L’idéologie de la magistrature ancienne de Jacques Kryne
De l’éminente dignité des juges… Autour de ‘L’idéologie de la magistrature ancienne de Jacques Kryne
Actes du colloque du 24 mars 2010
Publication en ligne : Télécharger
 Les changements climatiques et les défis du droit
Les changements climatiques et les défis du droit
Actes du colloque du 24 mars 2009
Publication aux Editions Bruylant en janvier 2010 (Direction : Catherine fabregoule et Christel Cournil)
Résumé Les changements climatiques font peser sur la planète des risques considérables tant du point de vue des milieux que de celui des espèces. Dans cette perspective annoncée, alors que les sciences dures semblent être les premières concernées, les sciences juridiques se sont emparées du sujet. Les défis du droit sont nombreux face aux changements climatiques en terme de prévention, d’adaptation, de sanction et de responsabilité. Les concepts existants sont mis à l’épreuve et de nouveaux concepts doivent se construire ou s’affiner avec pour toile de fond l’obsédante question de « l’effectivité-efficacité » de la norme. Cet ouvrage porte à la fois sur la prévention (Partie I), les enjeux futurs qui se dessinent autour d’une nécessaire justice climatique (Partie II) et enfin la gestion des impacts futurs des changements climatiques et de leurs effets induits (Partie III).
Publications 2009
 Les enquêtes fiscales : droit de visite et de saisie
Les enquêtes fiscales : droit de visite et de saisie
Actes du colloque coorganisé avec le CDPE (Université Cergy-Pontoise) et 2ISF, le 13 février 2009
Publication aux Editions LGDJ / Montchestien – Collection Les Grands colloques en mai 2009 (Direction : Christian Lopez)
Résumé: L’exercice par l’administration fiscale d’un droit de visite et de saisie, plus communément appelé « perquisition fiscale », dans les locaux professionnels des entreprises et les locaux d’habitation des particuliers, constitue à l’évidence un domaine particulièrement sensible des relations entre le fisc et les contribuables. Le dispositif des perquisitions fiscales n’est utilisé en France que depuis 1985, il n’existait antérieurement aucun texte spécifique. Pendant près d’un demi- iècle, l’administration fiscale a utilisé l’ordonnance du 30 juin 1940 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions économiques, en détournement de procédure quasi permanent. Près de 25 ans après l’instauration de l’article L. 16 B du LPF permettant à l’administration fiscale, lorsqu’elle soupçonne une fraude en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés ou de TVA, de solliciter une ordonnance du juge des libertés et de la détention afin de visiter tout lieu et saisir tout document se rapportant à la fraude, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France en concluant à la violation de l’article 6-1 de la Convention. En réaction, la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a tenté de tirer les conséquences de cette jurisprudence en modifiant le texte. Quelles sont les nouvelles voies de recours mises en oeuvre ? Quelles sont les inconnues qui subsistent ? De quels moyens dispose le contribuable pour se défendre ? Des procédés identiques existent-ils dans les législations étrangères ? Cet ouvrage est issu d’un colloque international associant universitaires et praticiens du droit fiscal venant d’Allemagne, d’Italie, d’Angleterre, d’Algérie, avec pour ambition de retracer l’évolution des pratiques de l’administration fiscale, des textes et de la jurisprudence afin de déterminer le caractère spécifique de ces pouvoirs d’investigations en constante adaptation au regard de la fraude fiscale et du respect des libertés individuelles.
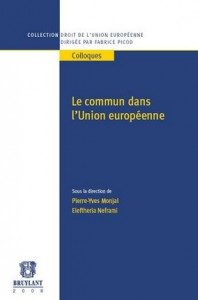 Le commun dans l’Union européenne
Le commun dans l’Union européenne
Actes de colloque
Publication aux Editions Bruylant en juin 2009 (Direction : Elefthéria Néframi et Pierre-Yves Monjal)
Résumé : L’avancement de l’Union européenne nécessite la compréhension des fondements du pouvoir commun. Mais le terme de commun, qui nous paraît si familier dans les différentes branches du droit public, recouvre-t-il une notion juridique permettant de réajuster les analyses sur le droit de l’Union européenne ? Quelle est la potentialité juridique du commun dans une Union européenne qui se substituera tôt ou tard à la Communauté ? Telles sont les questions que cet ouvrage entend poser, afin de contribuer à l’éclaircissement du sens théorique du commun, à partir et au-delà de ses manifestations juridiques. La délimitation du commun sur le plan théorique, historique et disciplinaire est suivie de l’étude de ses répercussions pratiques et de l’affinement de son analyse juridique permettant de dépasser le strict cadre communautaire pour rejoindre celui de l’Union.
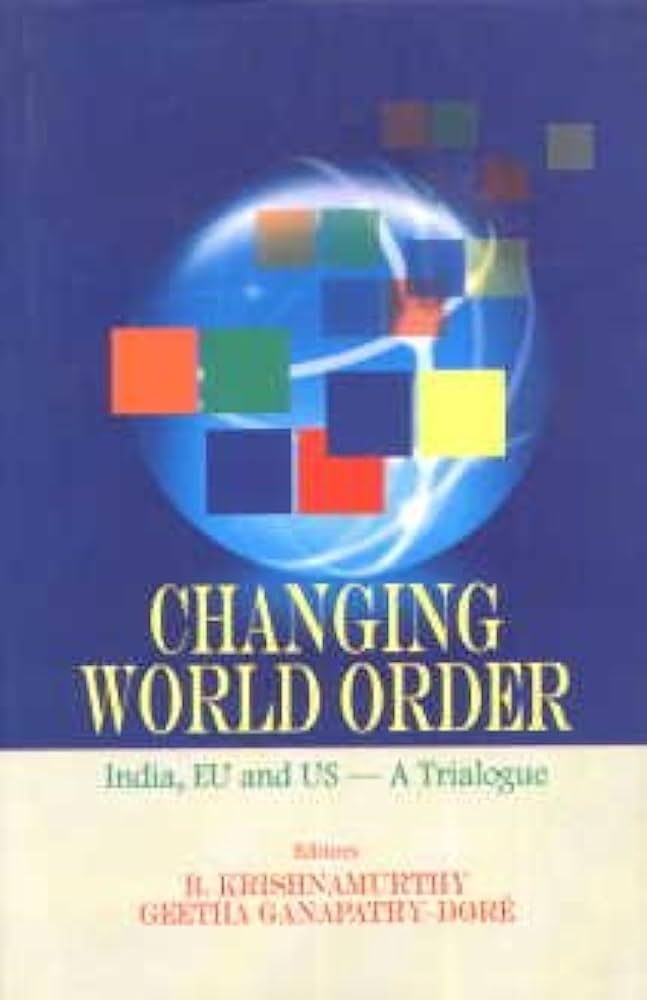 Changing World Order: India, EU and US : a trialogue
Changing World Order: India, EU and US : a trialogue
Actes du colloque de 2008
Publication aux Editions Shipra en 2009 (Direction : Geetha Ganapathy-Doré et B. Krishnamurthy)
Résumé : Moving beyond the antimonies of empire and decolonization, superpowers and Cold War, uni and multi-polar worlds, mature and emergingnations, the study of international relations today consists in finding a new paradigm for 21st century world order. Not ignoring the clash of civilizations and the specter of a morphed Anglophone Empire haunting the field after what has been described the ‘End of History’, the essays presented in this volume and writtenby scholars working in Indian and European universities in an inter and multi-disciplinary perspective offer a picture of the strategic realignments and the reconfiguration of power actually taking place under the combined pressure of the economic, financial, cultural and technological forces of globalization, international terrorism and climate change. They underscore the necessity for a trialogue among India, EU and US to ensure democratic regimes and the hope for peace, however fragile andprovisional it may be.
 L’office du juge
L’office du juge
Actes du colloque des 29 et 30 septembre 2006, au Palais du Luxembourg
Publication sur le site du Sénat en 2009 (Direction : Gilles Darcy et Mathieu Doat)
Publications 2008
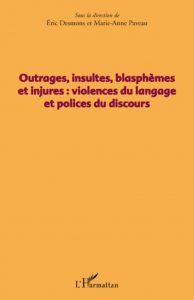 Outrage, insultes, blasphèmes, injures …
Outrage, insultes, blasphèmes, injures …
Actes du colloque des 16 et 17 mars 2007
Publication aux Editions L’Harmattan en juillet 2008 (Direction : Eric desmons et Marie-Anne Paveau)
Résumé : « Bougnoule, niakoué, raton, youpin / crouillat, gringo, rasta, ricain » chantait, il y a quelques années, un Jacques Dutronc désabusé, dans l’Hymne à l’Amour. Et la liste n’est évidemment pas exhaustive, tant le lexique est fourni… Autant de termes, autant de violences langagières, qui sont susceptibles d’un traitement pénal. La loi française matérialise en effet une police du discours et, en public en tout cas, il est entendu que l’on ne peut pas dire n’importe quoi avec n’importe qui. Sur cette thématique de la violence du langage, articulée à une pénalisation de la parole, juristes – universitaires ou praticiens -, linguistes, historiens du droit, psychanalystes et spécialistes de littérature ont décidé de se réunir pour confronter leurs analyses. Si l’approche juridique privilégie la définition de catégories aux frontières parfois ténues (outrage, injure, blasphème, diffamation), les approches linguistique et littéraire interrogent la production du sens en contexte et les effets de réception de ces paroles qui font acte. Les analyses détaillées et les nombreux exemples contenus dans l’ouvrage ne manqueront pas d’intéresser tous ceux qui, dans leur cadre professionnel, dans leur vie quotidienne, ou par simple curiosité intellectuelle, sont amenés à se pencher sur la question épineuse des limites de la correction et de la politesse dans les interactions verbales.
Publications 2007
 Les sanctions pénales fiscales
Les sanctions pénales fiscales
Actes du colloque organisé en en partenariat avec la société Thomson-Transactive et le Conseil régional d’Ile de France, le 26 octobre 2006
Publication aux Editions L’Harmattan en octobre 2007 (Direction : Thierry Lambert)
Résumé : Faire réprimer les manquements les plus graves par des sanctions pénales fiscales, pour donner un caractère dissuasif à la fraude fiscale, telle semble être la politique de l’administration fiscale qui en France est maîtresse de l’initiative de l’engagement des poursuites pénales. Les choix qui sont faits par l’administration et la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales, qui rend un avis non détachable de l’action publique et qui lie le ministre, sont souvent discutés par les praticiens, mais aussi plus largement par la doctrine. En va-t-il obligatoirement de même dans d’autres Etats ? S’agit d’une singularité française ? La qualification juridique des infractions, les modalités d’engagement des poursuites et leur opportunité, la procédure suivie, la responsabilité des personnes physiques et morales sont quelques unes des questions centrales mises en débat dans cet ouvrage. Les analyses des fiscalistes français sont-elles partagées par leurs homologues étrangers ? L’ouvrage réunit les contributions d’universitaires, souvent praticiens du droit fiscal, venant l’Algérie, d’Allemagne, du Canada, d’Italie, de Pologne et de Tunisie. Les contributeurs français sont les représentants de l’administration fiscale, du ministère de la justice, de la commission des infractions fiscales, des avocats spécialisés et des enseignants-chercheurs.
Publications 2006
 Les sanctions administratives fiscales : aspects de droit comparé
Les sanctions administratives fiscales : aspects de droit comparé
Actes du colloque organisé en partenariat avec la Société Thomson Transactive et le Conseil régional d’Ile de France , le 4 novembre 2005
Publication aux Editions L’Harmattan en mai 2006 (Direction : Thierry Lambert)
Résumé : L’ordonnance du 25 mars 2004 a supprimé un certain nombre de sanctions fiscales devenues sans véritable objet ou obsolètes. L’ordonnance de simplification du 7 décembre 2005 a permis de donner plus de cohérence et de lisibilité au dispositif. L’administration fiscale française dispose, de par la volonté du législateur, d’une gamme de sanctions qui ne se confondent pas avec les sanctions pénales. Cette situation est-elle singulière au regard des dispositifs mis en œuvre dans d’autres pays ? L’Italie, l’Allemagne, la Finlande et la Slovaquie nous donnent des illustrations différentes. Pour sanctionner des situations spécifiques, tels les paiements en espèces, la facturation de complaisance ou encore la distribution officieuse, le législateur a élaboré des sanctions particulières. Que dire par exemple de l’intérêt de retard, considéré pendant longtemps comme le seul prix du temps ? Cet ouvrage réunit les contributions d’enseignants -chercheurs, d’avocats fiscalistes et de représentants de l’administration fiscale. L’approche de droit comparé a permis d’associer des spécialistes, chercheurs et avocats, allemand, belge, slovaque, italien et finlandais ».
 Figures de la citoyenneté
Figures de la citoyenneté
Actes du colloque du 29 octobre 2004
Publication aux Editions L’Harmattan en mai 2006 (Direction : Eric Desmons)
Résumé : La politique n’a de cesse que de réactiver et de réaménager, sur des registres forts variés, une notion de citoyenneté fortement mise à l’épreuve par l’individualisme contemporain : on ne compte plus les appels aux comportements citoyens, les promesses de la citoyenneté européenne ou celles d’une possible citoyenneté du monde…De son origine gréco-romaine à nos jours, la citoyenneté a eu un parcours largement exploré par les sciences sociales. L’ambition modeste de cet ouvrage est de solliciter le savoir spécifique des juristes, historiens du droit, publicistes, privatistes sur certaines des formes qu’à pu prendre la citoyenneté dans l’histoire ».
Publications 2005
 Les groupes d’intervention régionaux
Les groupes d’intervention régionaux
Actes du colloque du 18 mai 2004
Publication aux Editions L’Harmattan en juin 2005 (Direction : Thierry Lambert et Dominique Turpin)
Résumé : Les groupes d’intervention régionaux (GIR) ont été créés par la circulaire interministérielle du 22 mai 2002, complétée par une instruction du 31 juillet de la même année. L’objectif est de lutter contre l’économie souterraine et les différentes formes de délinquance qui en découlent. Il s’agit d’associer pour la circonstance des policiers et des gendarmes, mais aussi des agents des douanes comme ceux de l’administration fiscale , sans oublier les fonctionnaires de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux encore de la direction du travail et de l’emploi. L’intervention des GIR est décidée conjointement par le préfet et le procureur de la République. La mutualisation des moyens administratifs et l’indépendance des procédures (douanières, fiscales,…) font l’objet de réflexions approfondies.
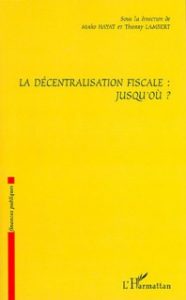 La décentralisation fiscale : jusqu’où?
La décentralisation fiscale : jusqu’où?
Actes du colloque coorganisé avec la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, avec la participation de la Gazette des communes, le 11 février 2004
Publication aux Editions L’Harmattan en janvier 2005 (Direction : Thierry Lambert et Mirko Hayat )
Résumé : Le principe d’une organisation décentralisée de la République est constitutionalisé, tout comme le fait que les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. Une loi de décentralisation, précise de façon concrète les nouvelles responsabilités confiées aux collectivités. Une loi organique fixe les conditions d’application du principe d’autonomie financière qui leur est applicable. La décentralisation fiscale va connaître une nouvelle étape. Cette perspective doit permettre de rénover, en la rationalisant, le système de financement local. Il semble difficile dans ces conditions d’échapper à une réflexion sur la fiscalité locale, jugée complexe pour le contribuable et insatisfaisante pour les collectivités. Cet ouvrage rassemble les contributions présentées lors d’un colloque où été confrontées les analyses des enseignants -chercheurs, avec le point de vue des élus et l’expérience des praticiens.
Publications 2002
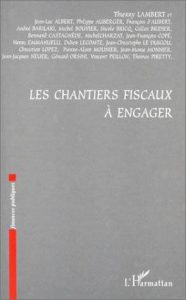 Les chantiers fiscaux à engager
Les chantiers fiscaux à engager
Actes de colloque
Publication aux Editions L’Harmattan en 2002 (Direction : Thierry Lambert)
Résumé : La réforme fiscale n’est pas un mythe, c’est une nécessité dans un monde qui change et dans une société qui se transforme. Il est indispensable pour qu’elle soit acceptée qu’un débat public et contradictoire s’installe visant à concilier le possible et le souhaitable. Chacun à sa place doit y participer si l’on veut donner un contenu nouveau au consentement à l’impôt. Sont réunies dans cet ouvrage les communications présentées autour de tables rondes consacrées à la refondation de l’impôt sur le revenu, à l’amélioration des procédures fiscales, à l’adaptation de la fiscalité des entreprises et à une prospective sur l’impôt pour demain. Elles réunissaient et confrontaient les réflexions d’élus, d’universitaires et de praticiens.
L’Union Européenne et la territorialité fiscale
Actes du colloque du 27 novembre 2001
Publication aux Editions Petites Affiches, n°97 du 15 mai 2002, Numéro Spécial (Direction : Thierry Lambert)
Résumé : La territorialité d’un impôt peut être appréhendée comme un ensemble de règles définissant l’application du prélèvement fiscal en fonction de la réalisation de la matière imposable. Un impôt est dit territorial lorsqu’il frappe seulement les opérations imposables réalisées dans le pays. Les régimes du bénéfice mondial, du bénéfice consolidé et du bénéfice intégré constituent des exceptions au principe de territorialité. Ces considérations de droit fiscal international doivent être appréciées dans le cadre de la construction de l’union européenne. Le marché intérieur est souvent présenté comme un espace sans frontières, notamment fiscales, régi par un principe de liberté de circulation. Qu’en est-il ? L’unité territoriale et le principe d’égalité, la réaction des Etats des Etats face à l’optimisation fiscale, l’évasion fiscale dans le cadre du marché intérieur sont quelques unes des questions traitées dans cette publication.
Publications 2000
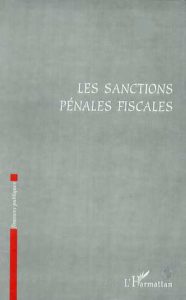 Les sanctions pénales en matière fiscale (séminaire franco-italien)
Les sanctions pénales en matière fiscale (séminaire franco-italien)
Actes du colloque d
Publication aux Editions L’Harmattan en mai 2000 (Direction : Thierry Lambert)
Résumé : L’ouvrage réunit les contributions de fiscalistes français et italiens qui s’interrogent sur la place des sanctions pénales fiscales dans le dispositif de lutte contre la fraude fiscale. La question de savoir si toutes les infractions au droit fiscal doivent être pénalement réprimées et celle des procédures mises en œuvre sont au cœur de l’ouvrage.
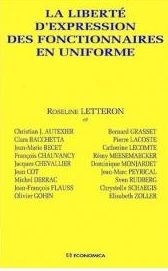 La liberté d’expression des fonctionnaires en uniforme
La liberté d’expression des fonctionnaires en uniforme
Acte du colloque du 2 décembre 1998
Publication aux Editions Economica en mai 2000 (Direction : Roseline Letteron)
Résumé : Le port de l’uniforme se situe au cœur d’une dialectique entre l’unité et la différence. En effet, il affirme à la fois la cohésion du groupe qui le porte, et sa volonté de se distinguer à l’intérieur de la société. Porté par un fonctionnaire, l’uniforme incarne à la fois la mission d’intérêt général dont il est investi, et la puissance de l’Etat, sa souveraineté. Qu’il soit magistrat, policier ou militaire, les porteurs d’uniforme sont généralement chargés d’assumer les fonctions régaliennes de l’Etat. Lorsqu’ils s’expriment c’est également l’Etat qui s’exprime. Il n’est pas surprenant, dans ces conditions, que leur liberté d’expression fasse l’objet de restrictions, au nom de la souveraineté de l’Etat. Ce sont ces restrictions, en France et à l’étranger, que cet ouvrage se propose d’étudier en associant des enseignants -chercheurs, des militaires, douaniers et autres fonctionnaires portant un uniforme.
Publications 1999
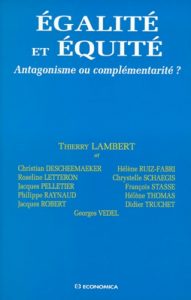 Egalité et Equité : antagonisme ou complémentarité ?
Egalité et Equité : antagonisme ou complémentarité ?
Actes de colloque
Publication aux Editions Economica en mai 1999 (Direction : Thierry Lambert)
Résumé : Le principe d’égalité énoncé le plus souvent dans le droit positif, affirrmé par la doctrine après de longs débats, consacré par la jurisprudence, semble céder le pas devant le concept d’équité souvent affiché mais au contenu rarement défini. Revendiquer plus d’équité, ne peut-il se concevoir qu’au détriment de l’égalité ? Le concept d’égalité et celui d’équité sont-ils complémentaires ou antagonistes ? Les notions de procès équitable et le concept de discrimination positive sont-ils de nature à diluer l’égalité au profit de l’équité ? Comment le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat et la Cour des comptes concilient-ils égalité et équité ? L’égalité de traitement et l’équité s’oppposent-ils en matière de politique sociale et de fiscalité ? Le Médiateur de la République est-il le gardien de l’équité au détriment de l’égalité ? L’ouvrage s’efforce de répondre à ces questions essentielles et à quelques autres.